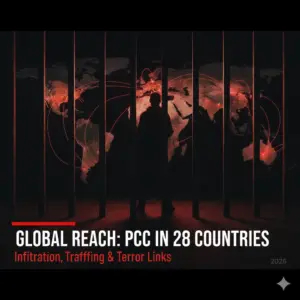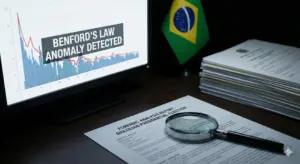Yanis Callandret, à la tête de la police judiciaire fédérale depuis 2018, dresse un constat sans détour : la Suisse n’est plus à l’abri des dynamiques violentes du crime organisé qui traversent l’Europe. Dans un entretien exclusif accordé à La Tribune de Genève, il décrit une situation préoccupante, marquée par une intensification des violences liées au narcotrafic et une présence de plus en plus visible des réseaux criminels internationaux.
Alors que l’opinion publique associe souvent les fusillades et le trafic de drogue à des villes comme Marseille ou Grenoble, Callandret affirme que la Suisse est déjà concernée. Des épisodes de tirs liés à des règlements de comptes ont eu lieu sur le territoire helvétique, et selon lui, il ne s’agit plus de savoir si le phénomène s’intensifiera, mais quand. L’exemple de pays longtemps perçus comme stables – Belgique, Pays-Bas, Suède – désormais confrontés à des scènes de guerre urbaine, démontre que la Suisse n’est pas une exception.
Le moteur principal de cette dynamique reste la cocaïne, dont l’arrivée massive sur le continent européen alimente un marché lucratif, structuré par des réseaux transnationaux aux ramifications multiples. Albanais, Italiens de la ‘Ndrangheta, Serbes, Nigérians, Turcs, motards comme les Hells Angels : tous occupent un rôle dans cette chaîne criminelle, de la production sud-américaine à la distribution locale. Plutôt que de s’affronter en haut de la pyramide, ces organisations coopèrent pour maximiser leurs profits. Ce sont les acteurs de terrain, les “petites mains”, qui se disputent les marchés locaux, avec la violence que cela implique.
Callandret souligne un phénomène préoccupant : la banalisation de la consommation. Autrefois réservée à une élite, la cocaïne est devenue une drogue accessible, présente dans toutes les couches de la société, y compris les zones rurales. Le prix du gramme, divisé par trois en vingt ans, a favorisé son adoption massive. « Pour certains, c’est la drogue de la fête ; pour d’autres, un stimulant pour tenir au travail. Elle est devenue une forme de dopage social », observe-t-il.
Ce constat s’inscrit dans une évolution plus large, marquée par l’émergence de drogues plus dures comme le crack – déjà visible en Suisse romande – et la menace à venir du fentanyl, qui dévaste l’Amérique du Nord. La Suisse surveille attentivement ces signaux faibles, en coopération avec les douanes et les partenaires européens.
Au plan politique, Callandret se refuse à commenter la question de la légalisation du cannabis, mais souligne que les organisations criminelles s’adaptent : elles investissent dans la production légale tout en contournant la réglementation pour maximiser leur marge, notamment en dopant illégalement le taux de THC.
L’un des enjeux majeurs, selon lui, est l’infiltration progressive des milieux économiques, administratifs et politiques. Il ne s’agit pas de fantasmes : des familles liées au crime organisé, notamment italiennes, sont implantées en Suisse depuis plusieurs générations. Certaines de leurs recrues accèdent à des postes d’influence. L’objectif des services de renseignement : déterminer si ces liens sont encore actifs et intervenir avant que le ver ne s’installe dans la pomme.
Interrogé sur une élue genevoise récemment arrêtée avec plus d’un kilo de cocaïne, Callandret refuse de commenter un cas précis mais y voit une illustration frappante de la porosité entre milieux politiques et criminalité.
Enfin, le chef de la PJ fédérale déplore un sous-investissement chronique dans les moyens humains de lutte contre le crime organisé. Sur les 400 postes prévus dans le plan initial de création de la police judiciaire, seuls 200 ont été pourvus, puis le processus a été bloqué pour des raisons budgétaires. Pourtant, les signaux d’alerte se multiplient. Le démantèlement récent d’un réseau à Sierre, inspiré des méthodes violentes des banlieues françaises, montre que le phénomène est bien implanté.
Pour Callandret, il ne s’agit pas d’un discours alarmiste, mais d’un constat lucide : « Les risques sont réels, et les cantons eux-mêmes le reconnaissent. Il est temps d’adapter nos moyens à la réalité. »